En attendant la publication imminente des nouvelles recommandations américaines pour la prise en charge du patient dyslipidémique, il est intéressant d’analyser les dernières mises à jour européennes, américaines et françaises sous l’angle du niveau de dépendance avec lequel elles ont été élaborées (liens d’intérêts des experts, choix des références bibliographiques et conclusion des recommandations) …

Les dernières recommandations européennes de la prise en charge des dyslipidémies, publiées par la Société Européenne de Cardiologie (ESC) et la Société Européenne d’Athérosclérose (EAS), datent de juillet 2011.
1.1. Liens d’intérêts potentiels des experts de l’ESC et de l’EAS
Les déclarations d’intérêts des experts ayant participé à l’élaboration de ces recommandations sont accessibles ici (accès vérifié le 20/02/2013). Voici l’analyse détaillée :
1.1.1 Les auteurs / Groupe de travail (Task Force Members)
Parmi les 18 experts ayant participé à ces recommandations :
- 1 seul (Paul DURRINGTON) ne déclare aucun lien d’intérêt avec l’industrie pharmaceutique.
- Les 17 autres ont reçu une rémunération personnelle de plusieurs laboratoires :
- 10 experts de la part d’AstraZeneca,
- 8 experts de Pfizer,
- 13 experts de Merck, MSD ou Schering-Plough (racheté par MSD).
- Certains experts ont perçu des rémunérations directement liées à des médicaments anticholestérols :
- 4 experts pour la rosuvastatine (CRESTOR®),
- 3 experts pour l’ézétimibe (VYTORIN® dans les pays anglo-saxons),
- 3 experts pour l’atorvastatine (TAHOR®).
- Aucun expert n’a déclaré de liens avec des entreprises ne commercialisant que des statines génériques.
1.1.2 Le groupe de relecture
Parmi les 27 relecteurs :
- 7 ne déclarent aucun lien d’intérêt avec l’industrie,
- 7 ont reçu des rémunérations personnelles ou institutionnelles d’AstraZeneca,
- 6 ont des liens avec Pfizer,
- 13 sont affiliés à MSD ou Schering-Plough.
1.1.3 Les membres du comité des recommandations pour la pratique de l’ESC
Sur les 20 membres du comité :
- Tous ont déclaré des liens avec l’industrie pharmaceutique,
- 4 ont des liens avec AstraZeneca,
- 2 avec Pfizer,
- 5 avec MSD.
1.1.4 Les liens d’intérêts du président de l’EAS, John CHAPMAN
John CHAPMAN, président de l’EAS et directeur de l’unité de recherche INSERM Dyslipidemia and Atherosclerosis Research Unit à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Université Pierre et Marie Curie, Paris), déclare :
- Prestations de conseil pour AstraZeneca, Danone, Kowa, MSD, Pfizer,
- Interventions en congrès pour AstraZeneca, Kowa Company, MSD,
- Subventions pour de la recherche clinique de la part de Kowa, MSD, Pfizer.
Source : http://www.medscape.org/viewarticle/755668 (cliquer sur « Faculty and Disclosures », accès vérifié le 20/02/2013)
1.1.5 Après la mise en évidence de malversations, quelle est la fiabilité des essais cliniques ?
Reste une inconnue de taille : après la découverte de malversations scientifiques, nous pouvons nous interroger sur la fiabilité réelle des essais cliniques sur lesquels sont basées toutes ces recommandations.
Le scandale Pr DON POLDERMANS :
- Ancien président des recommandations de l’ESC, il a été contraint de démissionner en novembre 2011 après avoir été convaincu de malversations scientifiques.
- Il dirigeait une équipe de chercheurs aux Pays-Bas et était impliqué dans plusieurs essais thérapeutiques falsifiés.
- Cela jette le discrédit sur l’ensemble de ses travaux, qui n’ont pas été réévalués scientifiquement.
Un essai clinique aux résultats spectaculaires : L’une des études concernées, publiée dans le New England Journal of Medicine en 2009 (Fluvastatin and Perioperative Events in Patients Undergoing Vascular Surgery), affichait des résultats extrêmement favorables :
- Comparant fluvastatine 80 mg et placebo chez 250 patients avant chirurgie vasculaire,
- Réduction de moitié des décès cardiovasculaires et infarctus du myocarde (4,8 % versus 10,1 %, p=0.03).
Des doutes sérieux sur ces résultats :
- Trop spectaculaires pour être crédibles,
- Non revérifiés par d’autres équipes de recherche.
Pour un accès public aux données scientifiques : Cet épisode renforce la nécessité de transparence dans la publication des données. La Revue Prescrire milite pour un accès libre aux données des essais cliniques.
À lire également : la conférence du Pr Peter GOTZSCHE sur l’importance de la transparence scientifique.
1.2 Bibliographie incomplète des recommandations européennes
Les recommandations contiennent 224 références bibliographiques, mais certaines études majeures sont absentes ou incomplètes :
1.2.1 Celles qui montreraient des bénéfices des médicaments anticholestérols produits par des laboratoires avec lesquels les experts n’ont aucun lien d’intérêts
Exemples d’omissions :
- Pravastatine – Étude MEGA (2006, Lancet) : le plus grand essai de prévention primaire réalisé avec la pravastatine, n’est pas référencée. Cette étude publiée en septembre 2006 dans le Lancet montre que cet anticholestérol moins puissant sur l’abaissement du LDL-cholestérol permet d’obtenir à son dosage le plus faible (10 mg) les meilleurs résultats sur la réduction de la mortalité globale et de la fréquence des événements cérébro- et cardio-vasculaires. Un essai effectivement bien trop embarrassant pour des experts dont les liens d’intérêts sont associés à d’autres anticholestérols, certes plus puissants sur la biologie, mais cela doit-il primer sur le bénéfice clinique ?
- L’analyse post-hoc de l’étude MEGA, qui montre le bénéfice de la pravastatine sur la mortalité toutes causes chez la femme, ne figure pas non plus dans les références bibliographiques.
- Suivi à 10 ans de l’étude 4S (Lancet, 2004) et de l’étude WOSCOPS (NEJM, 2007) : Absence de référence à ces études démontrant des bénéfices sur la mortalité toutes causes.
1.2.2 Celles qui montreraient les effets négatifs des médicaments produits par des laboratoires avec lesquels les experts ont des liens d’intérêts.
Exemples d’études défavorables non mentionnées :
- Étude ENHANCE (NEJM, 2008) : Première étude négative sur l’ézétimibe, ignorée dans les recommandations.Il est vrai qu’il aura fallu que deux parlementaires américains menacent pour que ses résultats défavorables soient enfin publiés, alors que l’étude était terminée depuis plus de deux ans…
- Étude SEAS (NEJM, 2008) : elle est référencée mais l’augmentation significative des nouveaux cancers et des décès par cancer observée avec l’ézétimibe n’est pas mentionnée dans la recommandation…
- Étude ASPEN (Diabetes Care, 2006) : a été conduite avec l’atorvastatine 10mg chez 2.410 patients diabétiques pendant 4 ans, soit un recrutement voisin de celui de l’étude CARDS, sans effets bénéfiques, n’est pas référencée
- Étude JUPITER (NEJM, 2008) : interrompue prématurément et dont la méthodologie a été très vigoureusement critiquée JUPITER Clinical Directions — Polling Results, Rosuvastatin in Patients with Elevated C-Reactive Protein – Correspondence, ne fait l’objet d’aucune réserve…
1.3 Conclusions biaisées des recommandations
Les sociétés savantes d’où sortent les experts recrutés pour élaborer des recommandations savent leurs financements dépendants des aides accordées par l’industrie. Dans la logique de la mauvaise gestion de leurs conflits d’intérêts, ces recommandations ne peuvent donc qu’être biaisées. Pour preuve les points élémentaires pour ne pas dire fondamentaux, suivants, qui auraient au moins pu faire l’objet d’un consensus, sont absents des 50 pages de ce « guidelines » européennes.
Points clés omis :
- Seules 2 statines sur les 5 commercialisées en Europe ont démontré un bénéfice clair sur la mortalité dans 5 essais thérapeutiques randomisés un : simvastatine (4S, HPS) et pravastatine (WOSCOPS, LIPID, MEGA).
- Les stratégies d’abaissement intensif du LDL-cholestérol n’ont pas prouvé d’impact sur la mortalité globale, mis à part dans l’étude JUPITER, tellement controversée.
- Les populations ne sont pas égales devant le risque cardiovasculaire. Il existe un gradient de risque CV entre le nord et le sud de l’Europe, en particulier pour les décès par cardiopathie ischémique (Voir l’article Statines en prévention primaire : entre mythe et certitude, quelle conduite tenir ? du même auteur sur le site Voixmedicales) …
- Le recours à de nombreuses méta-analyses, dont le niveau de preuve est moins important que celui des essais thérapeutiques randomisés, et pour lesquels l’hétérogénéité des recrutements devrait interroger sur la validité des conclusions, est systématique. Ces méta-analyses permettent un « repêchage » des statines qui n’ont rien démontré d’important au cours de leurs essais cliniques randomisées.
- Les stratégies recommandées privilégient, in fine, comme on devait s’y attendre à la vue des liens d’intérêts financiers déclarés par les experts, les dernières molécules promues par les industriels, sur un critère de jugement intermédiaire, à savoir leur puissance biologique : rosuvastatine, atorvastatine, ézétimibe seul ou associé à la simvastatine…
2. Recommandations américaines
2.1. Liens d’intérêts dans les recommandations américaines
Aux USA, les dernières recommandations datent de 2004, leur réactualisation par un groupe d’experts qui « planche » sur « la détection, l’évaluation et le traitement de l’hypercholestérolémie de l’adulte » étaient toujours attendues pour 2012. L’analyse des déclarations publiques d’intérêts établies lors des dernières recommandations, révèle que parmi les 9 experts :
- 1 seul n’avait aucun lien à déclarer.
- 6 experts ont reçu des honoraires d’AstraZeneca.
- 8 experts ont été rémunérés par MSD et/ou Schering Plough.
- 7 experts ont perçu des paiements de Pfizer.
- 5 experts de BMS (aucune statine n’était génériquée à l’époque).
En juillet 2004, au moment de la publication des dernières recommandations américaines pour la prise en charge des patients dyslipidémiques, aucune déclaration publique d’intérêts des experts n’était disponible. Il a fallu que la presse s’en mêle pour que le NIH (Institut National de la Santé aux USA) publie sur son site web la liste complète des experts et de leurs liens financiers avec les firmes.
2.2. Enquête journalistique sur les conflits d’intérêts
En décembre 2004, un journaliste, lauréat du prix Pulitzer, révélait dans le Los Angeles Times que l’un des auteurs de ces recommandations, qui en avait supervisé la rédaction, salarié à plein temps du NHLBI, avait perçu en plus de son salaire, 114 000 dollars d’honoraires de la part des firmes pour des prestations de consulting. Les principes de gestion des conflits d’intérêts par le NHLBI (Institut national cœur poumon sang) dénotent un certain laxisme, puisqu’il doit s’agir d’un acte volontaire (mais pas obligatoire ?) de la part des membres du groupe recommandations, qui déclarent oralement leurs liens lors d’une réunion générale et s’interdisent de voter s’ils ont un conflit d’intérêt potentiel. La liste des experts en charge d’actualiser les recommandations (Adult Treatment Panel IV) a été diffusée, mais pas leurs déclarations d’intérêts…
En tapant dans Google les nom et prénom du président du comité d’experts américains, Neil STONE, suivis de « disclosure of interests », la requête ramène en 2ème position un article du New York Time Magazine (NYT) daté du 3 novembre 2011, et intitulé « Les comités de recommandations en santé se débattent dans des conflits d’intérêts », faisant suite au travail d’investigation mené par les journalistes du magazine. « Si le comité d’experts qui a recommandé de ne plus dépister le cancer de la prostate chez la plupart des hommes, a effectivement veillé à écarter du vote tout expert ayant des conflits d’intérêts financiers, les comités d’experts chargés des recommandations concernant les principales causes de maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, cholestérol, et obésité, opèrent selon des règles éthiques bien moins contraignantes », explique-t-il.
Ainsi, selon le NYT, 7 des 16 membres du comité actuel, dont un vice-président, possèdent de trop nombreux liens financiers avec les firmes pharmaceutiques (tableau) et ne devraient pas être autorisés à voter. Le magazine rappelle que lors des dernières recommandations américaines, l’abaissement des seuils définissant l’hypercholestérolémie (taux cibles de LDL-cholestérol) avaient permis d’élargir le nombre de patients traités par statines de 13 millions à 36 millions…
2.3. Remise en cause des seuils de LDL-cholestérol
Plus récemment, Journal Sentinel, un média américain en ligne, a publié deux articles particulièrement bien documentés sur les liens d’intérêts des experts appartenant aux comités de recommandations pour la pratique clinique aux USA (ici), et les biais auxquels ils conduisent dans l’élaboration de ces recommandations (ici). Rodney A. HAYWARD, et Harlan M. KRUMHOLZ, deux chercheurs américains, ont écrit début 2012 une « lettre ouverte » à l’attention de ce groupe d’experts, pour lui demander d’abandonner la fixation de taux cibles de LDL-Cholestérol sur lesquels baser la prescription, pour trois raisons principales :
- Ils rappellent tout d’abord l’absence de tout fondement scientifique aux taux cibles de LDL-cholestérol. Les essais cliniques randomisés ont été réalisés à doses fixes. Ils n’ont pas montré que tous les médicaments qui diminuent les taux de lipides réduisent aussi les risques du patient. L’hypothèse selon laquelle l’abaissement du LDL-cholestérol augmenterait le bénéfice pour le patient en termes de réduction de la morbi-mortalité n’a pas été directement évaluée dans les essais thérapeutiques randomisés.
- En second lieu, il n’est pas prouvé que de traiter en cherchant à atteindre un taux cible de LDL-cholestérol soit sans danger,
- Enfin, les auteurs, s’appuyant sur leurs propres travaux (ici et là), ont estimé qu’une stratégie thérapeutique basée sur l’évaluation du risque cardiovasculaire global à 5 ou 10 ans, indépendamment du taux de LDL-cholestérol, permettrait de sauver chaque année 100.000 QALY (année de vie ajustée par sa qualité) supplémentaires, tout en ayant moins de patients sous fortes doses de statines qu’avec les stratégies basées sur les taux cibles de LDL-cholestérol. En effet, il s’avère que prescrire une statine en fonction d’un taux de LDL-cholestérol, conduit à la fois à des sur-traitements (chez des patients à faible risque CV et LDL élevées) et à des sous-traitements (chez des patients à haut risque CV et faible taux de LDL) Ces chercheurs, qui eux n’ont aucun lien d’intérêts avec les firmes commercialisant des hypolipémiants, n’en sont pas à leur premier galop d’essai, et Rodney HAYWARD avait voici quelques années dans une prestigieuse revue médicale démonté implacablement le dogme de l’abaissement du LDL-cholestérol sur des niveaux cibles (article).
3. Recommandations françaises
3.1. L’ANSM (anciennement, AFSSAPS)
Les dernières recommandations officielles de l’Afssaps (devenue ANSM) datent de mars 2005. Toutefois, elles ne sont plus accessibles sur le site de l’agence (source). Par une recherche Google, nous les retrouvons en ligne sur le site de la Société Française de Néphrologie (Recommandation, Argumentaire). Inutile de rechercher les liens d’intérêts chez les experts et les membres du groupe de lecture de l’époque. Ils n’auraient aucune chance aujourd’hui dans « l’après MEDIATOR® » de voir leur travail validé, tant ceux-ci étaient nombreux et les conflits qui en découlaient, brillaient par l’absence de leur gestion par l’agence sanitaire.
Pour beaucoup moins que cela, le Pr Dominique MARANINCHI, Directeur de l’AFSSAPS, puis de l’ANSM, a refusé récemment de valider une réactualisation de recommandation (Antibiothérapie par voie générale dans les infections respiratoires hautes et basses), provoquant la démission collective du groupe de travail de l’AFSSAPS sur les anti-infectieux. Cela dit, la composition des nouvelles commissions et des groupes de travail de l’ANSM a été récemment rendue publique ainsi que les déclarations d’intérêts des experts. Le moins que l’on puisse dire est que nous sommes encore loin d’une totale indépendance. Avec pas moins d’une cinquantaine de liens avec les firmes, jugés préoccupants pour les 7 membres du groupe de travail « Médicaments du système cardiovasculaire et les médicaments indiqués dans la thrombose », dont 18 responsabilités de co-investigateur d’essais cliniques pour l’un d’entre eux, Pierre-Yves HATRON, et 19 liens individualisés pour un autre, Philippe GIRAL, l’ANSM ne semble pas avoir épousé les exigences d’indépendance affichées par la Haute Autorité de Santé (Cf infra, les propos du Pr Gilles BOUVENOT, tenus devant la représentation nationale). D’autant, qu’elle semble blanchir les liens antérieurs, même d’un passé récent, dès lors que l’expert s’engage à les rompre pendant son mandat de 3 ans. Une drôle de conception de la gestion appropriée des conflits d’intérêts…
Les liens de ce groupe de travail peuvent être mieux visualisés que sur le site de l’agence en cliquant ici. L’ergonomie pour la consultation des DPI par tout un chacun a encore beaucoup à progresser. Et il ne s’agit que de transparence…
3.2 La Haute Autorité de Santé (HAS)
La HAS a publié en septembre 2010 un rapport « Efficacité et efficience des hypolipémiants : Une analyse centrée sur les statines ».
Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’une recommandation, comme s’en défend vigoureusement l’autorité (page 9 du rapport), dans un chapitre intitulé « Ce que ce travail n’est pas », il est possible de lire que « Ce travail n’est pas une recommandation de bonnes pratiques cliniques. Si une mise à jour des données cliniques depuis 2005 s’est avérée indispensable à sa réalisation, ce rapport ne constitue pas une actualisation des recommandations pour la prise en charge thérapeutique du patient dyslipidémique élaborées par l’Afssaps en 2005 ».
Néanmoins ce document officiel, qui n’a pas eu à être retiré par le nouveau Président de la Haute Autorité de Santé, le Pr Jean-Luc HAROUSSEAU, contrairement à d’autres recommandations qui sont passées au pilon suite au recours de l’association FORMINDEP, est au moins autant biaisé que les recommandations américaines, françaises (AFSSAPS) ou européennes (ESC/ESA)… Nous nous en étions inquiétés ici même en son temps (Cf. l’article : La mauvaise graisse de la HAS)
A noter que le Pr Gilles BOUVENOT, Président de la commission de la transparence à la HAS, a déclaré le mercredi 3 octobre 2012 devant la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale que « Hors un accident malheureux, 2011 aura été l’année du zéro conflit d’intérêt dans l’évaluation du médicament ». Quel dommage que cette commission intervienne aussi peu dans l’élaboration des recommandations de bonne pratique…
4. Discussion / Conclusion
En 2002, l’analyse des résultats d’une enquête publiée dans le JAMA montrait que 87% des 192 auteurs répondants, ayant participé à l’élaboration de 44 recommandations américaines et européennes pour la pratique clinique, entretenaient des liens avec l’industrie. Les travaux de recherche de 58% d’entre eux étaient financés par l’industrie et 38% avaient été employés par les firmes pharmaceutiques ou leur avaient monnayé des prestations de conseil… 59% avaient des relations avec les firmes commercialisant des médicaments concernés par les recommandations dont ils étaient les auteurs. 55% ont rapporté l’absence de formalisation des déclarations d’intérêts dans le processus d’élaboration des recommandations dont ils ont eu la charge. Seulement 7% considéraient que leurs relations avec les laboratoires pouvaient avoir une influence sur les recommandations qu’ils rédigeaient, et 19% que de telles relations entretenues par leurs collègues avec ces mêmes firmes pouvaient impacter les « guidelines »…
En 2005, un éditorial de la revue médical canadienne, CMAJ, comparait les conclusions diamétralement opposées de 2 recommandations pourtant relatives à la même thématique, à savoir, la prise en charge du diabète. L’une avait été élaborée par l’Association Canadienne du Diabète, sans gestion appropriée des nombreux conflits d’intérêts avérés de ses experts, et faisait la part belle à l’insuline glargine, alors que l’autre n’avait pas référencé cet antidiabétique. La problématique ne se limitait bien évidemment pas au diabète, mais concernait la quasi-totalité des guides de recommandations. Aussi, cette revue a-t-elle renforcé ses exigences en matière de transparence des liens d’intérêts non seulement vis-à-vis des articles qu’elle accepte de publier, mais aussi en direction des recommandations pour la pratique clinique.
En 2007, le New England Journal of Medicine publiait une tribune de Robert STEINBROOK, dans laquelle des directives étaient proposées pour l’élaboration des recommandations. Il faut savoir que plus de 2.000 recommandations pour la pratique clinique (RPC), principalement élaborées par des sociétés savantes, seraient répertoriées aux USA (ici) par l’AHRQ (Agency for HealthCare Research and Quality). Cette agence, équivalente à notre Haute Autorité de Santé, a été dessaisie en 1996 de l’élaboration des recommandations américaines après un scandale lié au lobbying de chirurgiens de la colonne vertébrale. Malheureusement les RPC postérieures à cet arrêt présenteraient une qualité méthodologique moins bonne et ne respecteraient pas certains pré-requis importants. Une bonne RPC se doit d’être valide, fiable, reproductible, applicable, flexible, claire, et d’avoir été développée selon une procédure pluridisciplinaire, faisant appel à des revues programmées à l’avance et à une solide recherche documentaire. Les recommandations reposent à la fois sur les données validées de la science et sur des opinions. Elles ne sont ni infaillibles, ni substituables au jugement clinique du professionnel de santé. L’auteur rappelle que le NICE fut le premier, en 2004, à adopter la règle de l’exclusion de tout expert présentant des conflits d’intérêts avérés de toute participation au processus décisionnel d’un projet de recommandations. Puis, il affirme que les RPC inspireraient bien davantage confiance, si elles étaient élaborées par des experts indépendants, sans aucun financement (direct ou indirect) par les firmes ou par tout autre tiers intéressé par l’issue des recommandations…
Pour conclure, les recommandations actuelles pour la pratique clinique en matière de prise en charge des patients dyslipidémiques sont fortement biaisées par la dépendance de leurs experts possédant des liens d’intérêts financiers avec les principales firmes pharmaceutiques bénéficiaires de leurs complaisantes conclusions. Un grand nombre d’autres recommandations [The Effect of Conflict of Interest on Biomedical Research and Clinical Practice Guidelines: Can We Trust the Evidence in Evidence-Based Medicine? [J Am Board Fam Pract September 2005 18:414-418.]] ne respectent pas non plus les standards de fiabilité et d’indépendance définis par l’Institute of Medicine. [Conflict of Interest Policies for Organizations Producing a Large Number of Clinical Practice Guidelines,[ PLoS ONE 7(5): e37413. doi:10.1371/journal.pone.0037413,]] Les patients et usagers de soins sont bien les dindons de la farce!
Edit : mars 2025 (amélioration mise en page et corrections minimes)






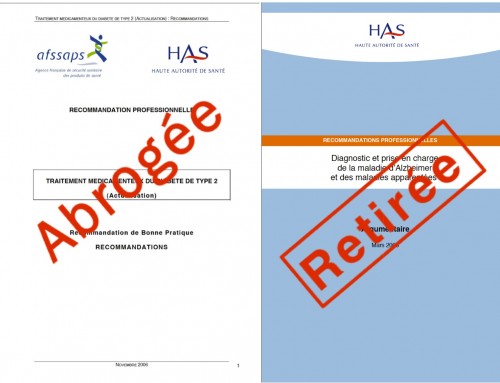
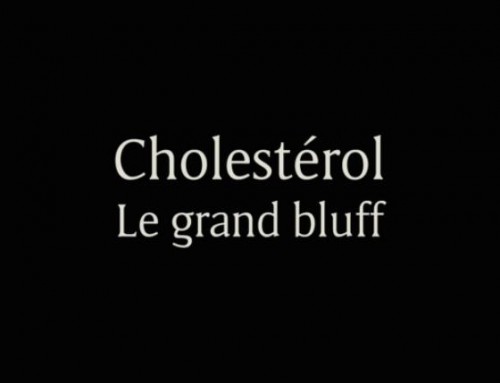
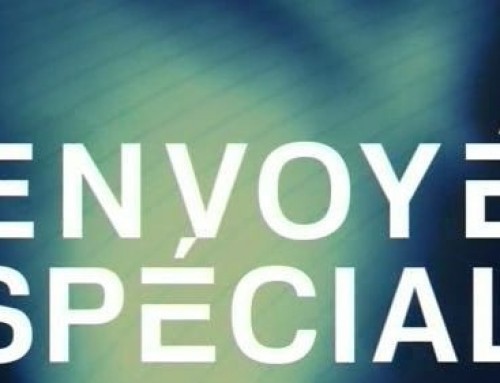
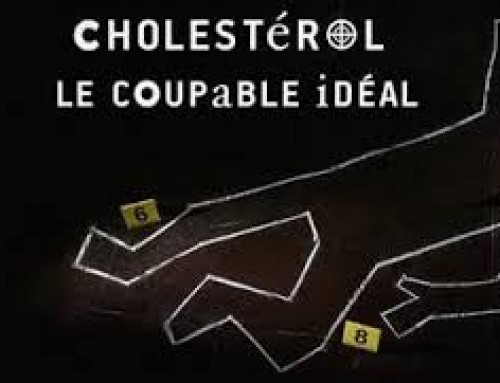
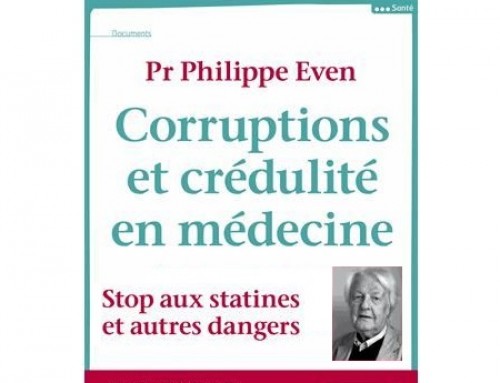

Bonjour,
La sécu du Royaume Uni semble avoir sonné la fin de la récrée : https://www.nhs.uk/news/heart-and-lungs/study-says-theres-no-link-between-cholesterol-and-heart-disease/
Tout le monde a toujours été d’accord pour dire que plus le HDL-cholestérol sanguin est élevé, plus faible est le risque cardio-vasculaire. La question ne s’était donc posée que pour le LDL-cholestérol, et bien en 2018, elle ne se pose plus : LDL-C does not cause cardiovascular disease: a comprehensive review of the current literature https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17512433.2018.1519391
Il n’y a plus de polémique à propos du cholestérol, même s’il reste encore quelques combats d’arrière-garde perdus d’avance.
Nombreuses sont les références bibliographiques indépendantes qui réhabilitent les graisses et mettent en garde contre les sucres raffinés, c’est à dire sans fibres, qui favorisent l’insulino-résistance chez les sédentaires. Le Royaume Uni taxe déjà les sodas sucrés.