Nous reproduisons ici l’interview intégrale donnée par Philippe Nicot le 20 septembre à Anne-Laure de Laval journaliste à l’Humanité Dimanche.

Anne-Laure de Laval :
Pourquoi a-t-on introduit le dépistage généralisé en 2004 en France, et avec quel objectif en termes de réduction de la mortalité ?
Philippe Nicot :
La France est rentrée tardivement dans un programme de dépistage organisé, alors qu’il avait été initié dans quelques départements. L’hypothèse était qu’il y aurait un bénéfice qui serait de l’ordre d’une réduction d’environ 30 % (26 à 34 %) à partir des données analysées par l’ANAES en 1999. Cette mise en œuvre s’est faite alors que l’analyse de Peter Gøtzsche, en 2001 concluait à l’absence de bénéfice du dépistage organisé. Le fait qu’avant 2004 il y ait eu en France des départements pilotes est important. Cela a en effet permis à Bernard Junod, épidémiologiste membre du Formindep, de faire une évaluation comparative de cohortes pures, c’est-à-dire des départements ayant un programme avec des départements ne participant pas à un programme de dépistage. Les résultats inquiétants de Bernard Junod l’avait conduit à alerter les préfets des départements concernés.1)http://www.jle.com/fr/revues/medecine/med/e-docs/00/04/3A/2F/article.md?type=text.html
Anne-Laure de Laval :
8 ans après, peut-on établir un premier bilan, sachant que 53 % des femmes y participent ? Que peut-on déjà mesurer, et que constate-t-on ?
Philippe Nicot :
Votre question laisse entendre qu’avant 2004 on ne faisait pas de dépistage. C’est inexact. Il était d’abord organisé dans quelques départements depuis le début des années 1990. Par ailleurs le dépistage, c’est-à-dire la réalisation de mammographie de manière systématique sans que les femmes ne se plaignent d’aucun signe se pratique depuis de nombreuses années. C’est un point important car il faut du recul pour évaluer les choses. Nous disposons depuis 1980 et jusqu’en 2005 des données de mortalité et des données d’incidences (c’est-à-dire de nouveau diagnostic porté de cancer du sein). Alors que le nombre de nouveaux cas découvert a flambé, et multiplié par 2,5, le taux de mortalité par cancer du sein a faiblement diminué (10,7 % selon l’OMS pour la période de 1989 à 2006). Dans une étude publiée en 2011 dans le BMJ, Philippe Autier a comparé l’évolution de la mortalité dans des pays européens. Les pays très proches en terme de population, de conditions socio-économiques, et d’organisation du système de santé ont été appariés deux par deux. Son constat est sans ambiguïté : alors que les politiques de dépistage du cancer du sein et leurs dates de mise en place étaient différentes, les résultats globaux en terme de mortalité étaient comparables entre les deux pays, ainsi que concernant les périodes de baisse. Sa conclusion logique était que le programme de dépistage ne jouait pas un rôle direct concernant la réduction de la mortalité par cancer du sein observée.
Anne-Laure de Laval :
Dans les pays qui, comme la Suède, ont instauré le dépistage généralisé depuis les années 1970, quelle a été la diminution de la mortalité (selon quelles études, et pourquoi elles vous paraissent fiables) ?
Philippe Nicot :
Philippe Autier a publié fin juillet 2012 dans le Journal of the National Cancer Institute, l’évaluation sur près de 30 ans (de 1972 à 2009), de la mortalité en Suède. Celle-ci a diminuée de 0,98 % par an. Surtout ont pu être comparées des régions qui avaient mises en œuvre le dépistage avec des périodes différentes. Sa conclusion est qu’il n’y a pas d’effets positifs du dépistage.
Cette étude me parait fiable car elle prend en compte une durée d’analyse de près de 30 ans, ce qui est la plus longue étude d’observation, qu’elle a pu faire des comparaisons entre des régions ayant eu des pratiques de dépistage différentes. Par exemple deux groupes ont vu leur mortalité diminuer de 12 % avant l’introduction du dépistage. Enfin, elle a été publiée dans une très grande revue internationale (sa réputation sur le facteur d’impact est de 15). Je rajouterai la réputation internationale de Philippe Autier, c’est un spécialiste mondialement reconnu de l’évaluation des programmes de dépistages des cancers, notamment auprès de l’Institut International de Recherche sur le Cancer, émanation de l’OMS. Lorsque quelqu’un de cette réputation, publie des informations dans une revue d’un tel niveau qui vont à l’encontre des données admises, c’est pour moi un évènement très important. Il est impossible de publier des données qui remettent aussi formellement en cause le dépistage surtout en Suède si elles ne sont pas en « béton armé ».
A l’inverse, Puliti et Duffy ont publié leur étude dans une revue quasi inconnue, le Journal of Medical Screening. Si leur étude avait été de bonne qualité, elle aurait été publiée dans une revue majeure. Il y a pourtant un enjeu majeur à diffuser dans les meilleures revues les résultats les plus solides.
Depuis 2006, nous avons appris que les résultats très optimistes des essais cliniques suédois de Lászlö Tabár n’étaient pas compatibles avec les données officielles des registres de cancer. En 2012, nous avons mené au Formindep une enquête sur les conflits d’intérêts de Lászlö Tabár, que nous avons publié dans le Lancet. Notre constat était lourd puisque nous avons identifié des intérêts majeurs qu’il n’a jamais déclaré dans ses différentes publications internationales, et cela en contradiction avec les règles éthiques. Au Formindep, nous sommes très inquiets de notre découverte, car quelqu’un qui ne dit pas la vérité sur ses liens d’intérêts entache sa crédibilité.
Anne-Laure de Laval :
On parle désormais beaucoup du surdiagnostic, qui serait de 5 à 10 % selon certaines études, et à 30 % selon d’autres ? Qu’appelle-t-on surdiagnostic, et pourquoi y a-t-il de tels écarts de résultats selon les études ? Sur lesquelles vous fondez-vous, et pourquoi ?
Philippe Nicot :
Un surdiagnostic est un cancer identifié à l’examen anatomo-pathologique qui ne va pas avoir l’évolution défavorable d’une maladie cancéreuse. Vous avez d’un côté des cellules cancéreuses qui sont identifiées au microscope. De l’autre vous avez une maladie évolutive qui va grossir, et se répandre. Pendant de nombreuses années, nous avons cru que toutes les cellules cancéreuses donneraient une maladie cancéreuse généralement mortelle, et sur ce principe nous avons décidé de traquer le plut tôt possible ces cellules dans l’espoir qu’elles n’évolueraient pas vers des maladies cancéreuses. Hélas, cette hypothèse est fausse, et nombre de ces cellules cancéreuses ne vont pas évoluer vers une maladie cancéreuse. C’est une bonne nouvelle. Pour le cancer du sein, nous avons même des études qui prouvent que des cancers invasifs guérissent spontanément sans qu’on en connaisse la raison. Depuis une dizaine d’années les spécialistes ont pris conscience de ce surdiagnostic et essayé de le mesurer. En 2006, la célèbre Revue Prescrire dans une analyse très minutieuse a conclu que ce surdiagnostic se situait dans une fourchette située entre 30 et 50 %. Depuis, les études les plus réputées ont confirmé ces chiffres. Bernard Junod en 2011, a conclu en France à un chiffre de 76 %. Il existe aussi des chercheurs qui minimisent ces chiffres, et donnent une fourchette comprise entre 1 et 10 %, comme c’est le cas de Pulitti et Duffy. Ces auteurs ont exclu les études qui ne prennent pas en compte « l’avance au diagnostic ». En fait ce facteur n’intervient qu’au moment de l’installation du programme de dépistage, on peut constater alors un pic d’incidence des cancers qui chutent ensuite. Il n’y a donc aucun raison d’exclure ces études. Quatre études majeures, publiées dans de grandes revues sont ainsi sorties du champ de leur analyse, ce sont celles de Philippe de Autier, de Per-Henrik Zahl et Peter Gøtzsche, et de Bernard Junod. Cela nous semble incroyable. Mais lorsque nous regardons de plus près les auteurs exclus, il apparait que ce sont des auteurs de référence qui depuis des années sonnent l’alerte au niveau international, et contestent le bienfondé de ce dépistage par mammographie. On voudrait faire taire les critiques qu’on ne s’y prendrait pas autrement. Si l’analyse de Puliti et Duffy était valable, comme je l’ai écrit ci-avant, elle aurait été publiée dans de très grandes revues, ce qui n’a pas été le cas.
Nous avons bien pris connaissance de l’étude française de Seigneurin publiée dans le BMJ en novembre 2011, il est important de souligner qu’il s’agit d’une étude virtuelle avec une simulation stochastique. Cette étude a entrainé de très fortes critiques dans le BMJ, parmi celles-ci le fait que les auteurs aient utilisé une méthode extrêmement complexe et très difficilement compréhensible. L’auteur en convient lui-même « l’incertitude et la complexité sont les principales limites de cette approche par modélisation ». Les auteurs ont par ailleurs exclus des causes de surdiagnostic. Ils écrivent « Nous nous sommes limités aux maladies non-progressives ; le surdiagnostic résultant de cancers progressifs ne fut pas pris en compte du fait de l’existence de causes de décès concurrentielles qui ne rentraient pas dans le cadre de cette étude. »2)Lire la transcription en français de Rachel Campergue sur son site : [http://www.expertisecitoyenne.com/2012/01/16/dans-un-monde-virtuel-le-surdiagnostic-n%E2%80%99existe-pas/#more-141
Anne-Laure de Laval :
Quels sont les effets de ce surdiagnostic pour les femmes traitées, et des surtraitements qu’il induit? (quelques éléments chiffrés si possible)
Philippe Nicot :
L’annonce d’un diagnostic est, quelle que soit la manière dont l’équipe médicale s’y prend, l’annonce d’une très mauvaise nouvelle. C’est un traumatisme psychologique. Le médecin généraliste que je suis constate à quel point ces femmes sont traumatisées. D’un seul coup, la femme passe du stade de bien portante, femme active, épouse, mère ou grand-mère, au statut de malade avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Tout débute par le diagnostic avec toute une série d’examens, puis une intervention chirurgicale et des traitements complémentaires de type chimiothérapie ou radiothérapie, et un arrêt de travail d’au moins six mois, avant une reprise d’activité peut-être à temps partiel. Le prix humain de ce traitement est légitime, et les patientes auront raison de l’accepter en cas de maladie cancéreuse avérée. _ Imaginez par contre ce qu’il en est en cas de surdiagnotic : ce traumatisme et ces traitements agressifs pour rien ! Des vies « bousillées » pour rien. Les défendeurs de ces programmes, lorsqu’ils abordent le surdiagnostic et le surtraitement, en restent à des images très neutres et se gardent bien d’aborder ces aspects. C’est d’ailleurs étonnant de voir le contraste avec ce qui se passe pour un médicament. Si vous prenez n’importe quel médicament, vous allez lire les effets secondaires qu’ils peuvent entrainer. Dans le cas du dépistage, la notice n’est pas fournie. Parce que les défenseurs pourraient penser que cela effraierait les femmes ? Mon constat est qu’elles ne sont pas informées de manière satisfaisante. J’ai réalisé il y a un an une analyse de la qualité de l’information délivrée 3)http://www.voixmedicales.fr/2011/11/14/depistage-organise-du-cancer-du-sein-information-ou-communication/ qui est très éloignée de ce que les femmes sont en droit d’attendre.
Pourtant il existe des critères précis sur lesquels les institutions devraient s’appuyer pour informer loyalement les femmes. La collaboration Cochrane de Peter Gøtzsche, à partir des études de meilleur niveau de preuve, les essais contrôlés, a calculé que pour 2 000 femmes participant au dépistage pendant 10 ans, une aura évité un décès prématuré par cancer du sein et 10 auront été victimes d’un surdiagnostic et des traitements inutiles et dangereux qu’il entraîne. Il a réalisé un document de référence pour l’information des femmes. Un document régulièrement actualisé. Une traduction française a été réalisée par le Thierry Gourgues médecin, secrétaire du Formindep. Elle est disponible ici.
Anne-Laure de Laval :
Est-ce que le développement d’outils diagnostiques distinguant les carcinomes in situ sans gravité de ceux qui justifieraient d’être traités permettrait de mettre fin à la polémique. Est-il en cours ?
Philippe Nicot :
Question difficile. Cette étude serait une étude à long terme, il faudra mesurer la croissance et l’évolutivité de la tumeur. Je ne vois pas en quoi elle réglerait le problème du dépistage par mammographie. Il y a un paradoxe difficile à résoudre, qui est que si des tumeurs sont visibles à la mammographie sans être palpable, il existe tout autant des cancers palpables mais non visibles à la mammographie, malgré la qualité du cliché et celle des radiologues.
Anne-Laure de Laval :
Au Formindep, vous estimez que trop d’intérêts médiatiques, politiques et commerciaux agissent en synergie dans ces campagnes de dépistage : pouvez-vous préciser ? M. Viguier, quel est votre avis sur ce point ?
Philippe Nicot :
Octobre Rose est une campagne commerciale, avec son lot de tee-shirt, de gadgets, de slogans, voir même de pèlerinage… On en est rendu au ruban le plus long. Nous sommes bien loin du débat scientifique.
Schwartz et Woloshin dans le BMJ du 2 août 2012 ont fait une analyse des messages de la campagne de la fondation Komen, une très puissante organisation caritative. Leur constat est assez clair : comment une organisation caritative exagère les bénéfices de la mammographie4)http://www.expertisecitoyenne.com/2012/08/06/komen-epinglee-dans-le-bmj/.
Je note d’ailleurs que pour parler des données qui vont à l’encontre de la croyance des bénéfices du dépistage, le mot «controverse» est employé. Or l’analyse scientifique est par définition celle du doute, nous formulons des hypothèses. Donc la controverse est par définition scientifique, ce qui la différencie de la propagande. Mais en plus du problème scientifique, il y a le problème humain. Comme je viens de l’aborder, ce ne sont pas des clichés de radiologie dont nous parlons, ce sont bien des femmes, et d’un organe à très fort pouvoir symbolique, le sein. Quant à l’aspect politique, il est évident qu’à l’heure de la performance, vu l’investissement fait par les institutions, elles ont un intérêt à en faire la promotion. Des institutions qui se sont lancées corps et âmes dans le dépistage organisé pour convaincre 80 % des femmes, peuvent-elles encore garder suffisamment de sens critique pour dire « stop, on arrête on s’est trompé ». Elles sont arrivées à un point de non-retour. Il va leur falloir un grand sens stratégique pour sortir la tête haute et sans qu’un scandale explose.
Anne-Laure de Laval :
Pour résumer, sur quoi vous fondez-vous essentiellement aujourd’hui pour dire que les bénéfices du dépistage sont supérieurs aux risques, ou l’inverse ? Et qu’est-ce qui vous ferait changer d’avis ?
Philippe Nicot :
En juillet 2011, j’écrivais publiquement mon désaccord avec la recommandation de la HAS sur la participation au dépistage du cancer du sein. « Il n’y a plus de donnée scientifique solide permettant de recommander le dépistage du cancer du sein de manière individuelle ou organisée. En effet, le bénéfice en terme de mortalité est constamment revu à la baisse, et tant le surdiagnostic que le surtraitement ont des conséquences néfastes de mieux en mieux connues et importantes. » Un an plus tard, je constate que les données scientifiques publiées dans les meilleures revues me confortent dans cette position. Va venir le temps de la remise en cause de ce dépistage. La HAS avait repris à son compte de manière assez subtile et discrète mon analyse. On peut ainsi lire dans le document de synthèse5)http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-07/synthese_et_recommandations_participation_depistage_cancer_du_sein.pdf : « La décision de dépister ou non est alors en partie déterminée par l’appréciation au niveau individuel et/ou collectif de la balance bénéfice risque associée à la procédure. Cette décision a été prise, à l’échelle collective, sur la base de la baisse attendue des taux de mortalité par cancer du sein associée au dépistage par mammographie. Or, l’actualisation des méta-analyses et les données en population ont montré que l’impact des programmes sur la mortalité était plus faible qu’attendu dans plusieurs pays ayant mis en place précocement un programme de dépistage. »… Et émettait une hypothèse de sortie de crise : « L’objectif des présentes recommandations n’est pas de prendre position sur la controverse, ni de remettre en cause l’intérêt du dépistage chez les femmes de 50 à 74 ans, dans la mesure où cette question devrait faire l’objet d’une revue approfondie de la littérature et n’est pas l’objet de la présente saisine ».
Anne-Laure de Laval :
Comment sortir par le haut de cette polémique ? Faut-il envisager un « moratoire », une réévaluation de l’intérêt du dépistage ? Une meilleure information à destination des femmes ?
Philippe Nicot :
Le terme polémique tendrait à dire qu’il y a des méchants qui font des griefs à des gentils. Il est vrai que le débat scientifique que je porte dans cette interview a de quoi dérouter le nombreux public qui adhère au discours officiel. Le point important à comprendre est selon moi que les autorités se sont investies de manière très ou trop importante dans ce dépistage. Elles se trouvent de fait en danger devant les données scientifiques actuelles. Je remarque d’ailleurs qu’elles sont contraintes de s’appuyer sur une étude publiée dans une revue inconnue qui de plus a occulté de son analyse les résultats négatifs des études publiées elles dans les meilleures revues. La réévaluation du bénéfice-risque est la solution qu’ont adoptée les anglais. Si les autorités françaises avaient pensé que cette solution les conforterait dans un bénéfice-risque favorable au dépistage, elles l’auraient réalisée depuis quelques années. Mais comme je l’ai expliqué, les données les plus solides vont à l’encontre d’un bénéfice-risque favorable, et les autorités risquent de se heurter officiellement à un résultat négatif qu’elles auront beaucoup de mal à expliquer à la population française, qui depuis des années est bercée de l’illusion d’une efficacité. Mais faire passer les lanceurs d’alertes pour des polémistes est un jeu dangereux que l’on trouve derrière tous les scandales sanitaires. Le moratoire me semblerait une bonne solution. Mais la population française va-t-elle être prête à entendre cette nouvelle ? Améliorer l’information délivrée ? Oui absolument. Il faut sortir de ce cercle vicieux c’est-à-dire à la fois supprimer cet enjeu de vouloir convaincre 70 ou 80 % des femmes, et leur délivrer une information réelle et concrète sur les conséquences d’un surdiagnostic et d’un surtraitement. Une question est délicate. Comment, en effet, un médecin peut-il délivrer une information « claire, loyale, adaptée » à une femme s’il est lui-même persuadé que le dépistage organisé sauve des vies ? En effet, il y a d’un côté des médecins qui sont convaincus, parce que au fond d’eux la croyance est que plus un cancer est découvert tôt, mieux c’est. En même temps ils ont très peur de passer à côté d’un diagnostic, ce qui les conduirait à la fois à une grande culpabilité et peut-être à un procès. Le choix du dépistage est donc celui de la facilité. Choix d’autant plus facile que par ailleurs l’assurance maladie a mis en place un système d’incitation financière si leurs patientes réalisent la mammographie. De l’autre côté il y a les lecteurs de la Revue Prescrire ou de la Revue Médecine qui connaissent très bien les données que j’exposais plus avant, mais qui vont se heurter à des femmes qui auront été invitées par l’association de dépistage. Il leur est difficile d’exposer alors un message radicalement différent du message officiel. Il me semble indispensable que les médecins retrouvent leur indépendance dans l’information loyale qu’ils doivent à leurs patientes, ce qui doit amener l’assurance maladie à retirer cet indicateur de sa rémunération à la performance. Enfin il y a une autre solution, qui est d’ailleurs mise en place progressivement, qui est de laisser les contradicteurs s’exprimer. Le livre de Rachel Campergue a d’ailleurs permis il y a un an d’aborder sainement cette contradiction. Elle anime désormais un blog6)http://www.expertisecitoyenne.com de haut-niveau. Philippe Autier a bénéficié d’une belle tribune dans le bulletin de l’ordre national des médecins 7)http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cn_bulletin/medecin21_web.pdf. Et bien sûr le Formindep s’exprimera autant que possible.
Post Scriptum :
Philippe Nicot est médecin généraliste, membre du Formindep et expert de la HAS pour la recommandation sur la participation dépistage du cancer du sein des femmes de 50 à 74 ans en France.
Quelques jours après cette interview, le 26 septembre 2012, la revue indépendante Que Choisir a publié un dossier sur le dépistage du cancer du sein et le 04 Octobre, à l’occasion de la remise du Prix Prescrire 2012 qui récompense chaque année des livres ou documents remarquables, la Revue Prescrire organisa une conférence-débat avec Peter Gøtzsche.
Philippe Nicot a été par ailleurs l’invité de Jean-Jacques Bourdin sur Radio Monte-Carlo le jeudi 27 septembre 2012 :
References


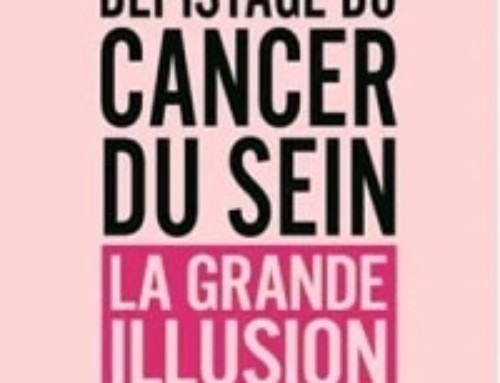


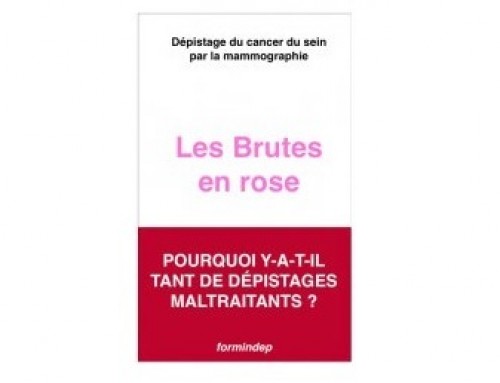

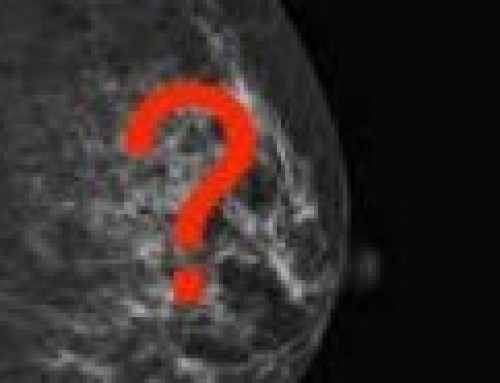

Laisser un commentaire